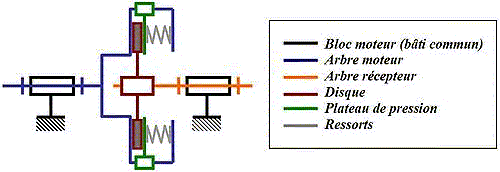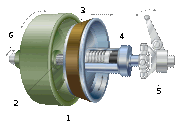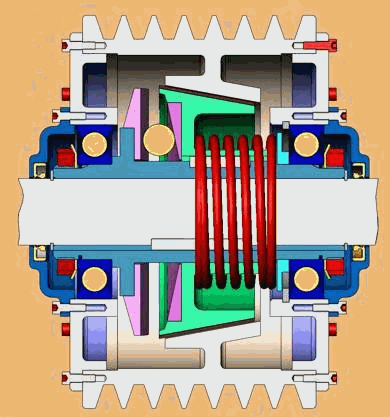CHAP Xii : EmbrayageS et freinS.
Ces deux mécanismes offrent beaucoup similitudes, et sont étudier dans ce même chapitre.
I. EMBRAYAGE.
L'embrayage est un dispositif d'accouplement temporaire entre un arbre dit moteur et un autre dit récepteur. Du fait de sa transmission par adhérence, il offre une mise en charge progressive de l'accouplement qui évite les à-coups qui pourraient provoquer la rupture d'éléments de transmission ou le calage dans le cas d'une transmission depuis un moteur thermique.
Sur les véhicules automobiles, l'embrayage est nécessaire parce que les moteurs thermiques doivent continuer à tourner même si le véhicule est à l'arrêt. Le désaccouplement facilite aussi le changement de rapport de vitesses. L'embrayage trouve donc sa place sur la chaîne de transmission, entre le moteur et la boîte de vitesses.
On opposera les embrayages aux systèmes à crabotage qui assurent un accouplement par obstacle et qui n'autorisent donc pas une mise en charge progressive.
I. 1. Embrayage disque.
|
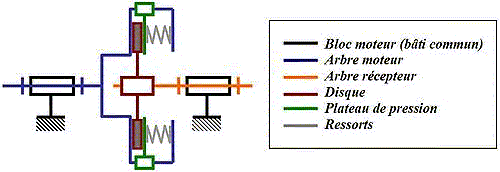 |
|
1. Arbre moteur.
2. Volant moteur.
3. Disque d'embrayage solidaire de 6
4. Plateau de pression du mécanisme.
5. Ressort.
6. Arbre de sortie
A : Embrayé. B : débrayé.
|
 |
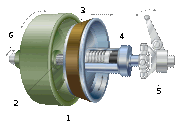 |
I. 2. Embrayage
conique.
Son intérêt réside dans le fait qu'il est autobloquant :
l'assemblage conique reste coincé en l'absence d'effort presseur. Le couple
transmissible à encombrement identique est plus élevé qu’avec un embrayage
disque, par contre il faut agir pour débrayer.
|
I. 3.
Embrayage centrifuge.
Dans ces dispositifs, l'embrayage est commandé par la vitesse de rotation de l'un des deux arbres sous l'effet de la force centrifuge. Ce dispositif permet que le moteur atteigne son régime de couple maximum avant d’embrayer le récepteur.
|
Arrêt ou vitesse faible. Le ressort dégage le cône, la poulie n’est pas entraînée. |
L’arbre tourne, les billes s’écartent, translatent le cône et embrayent la poulie. |
|
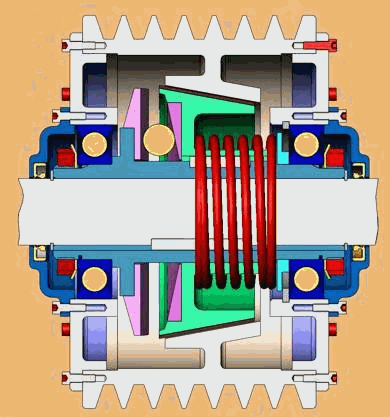
|

|
I. 4. Dimensionnement. (Valable pour les freins).
Le couple transmissible par un embrayage dépend du matériau constituant les garnitures, du nombre et des dimensions des surfaces de frottement entre disques ainsi que de la force exercée par les ressorts.
En première approximation : C= n.f.F.R
n = nombre de surfaces de friction.
f = coefficient de frottement.
F = effort presseur.
R = rayon moyen de la surface de frottement.
En deuxième approximation : C= n.f.F.Req
Avec 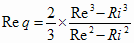 et Re et Ri rayons intérieurs des surfaces de frottement.
et Re et Ri rayons intérieurs des surfaces de frottement.
Les performances, notamment le coefficient de frottement, restent liées à la température. Celle-ci s'élève rapidement lorsque les disques patinent. L'ensemble doit donc pouvoir être refroidi. Valable aussi pour les freins.